La grande aventure du voyage
Revue La Vie des Bêtes N°96 de juillet 1966
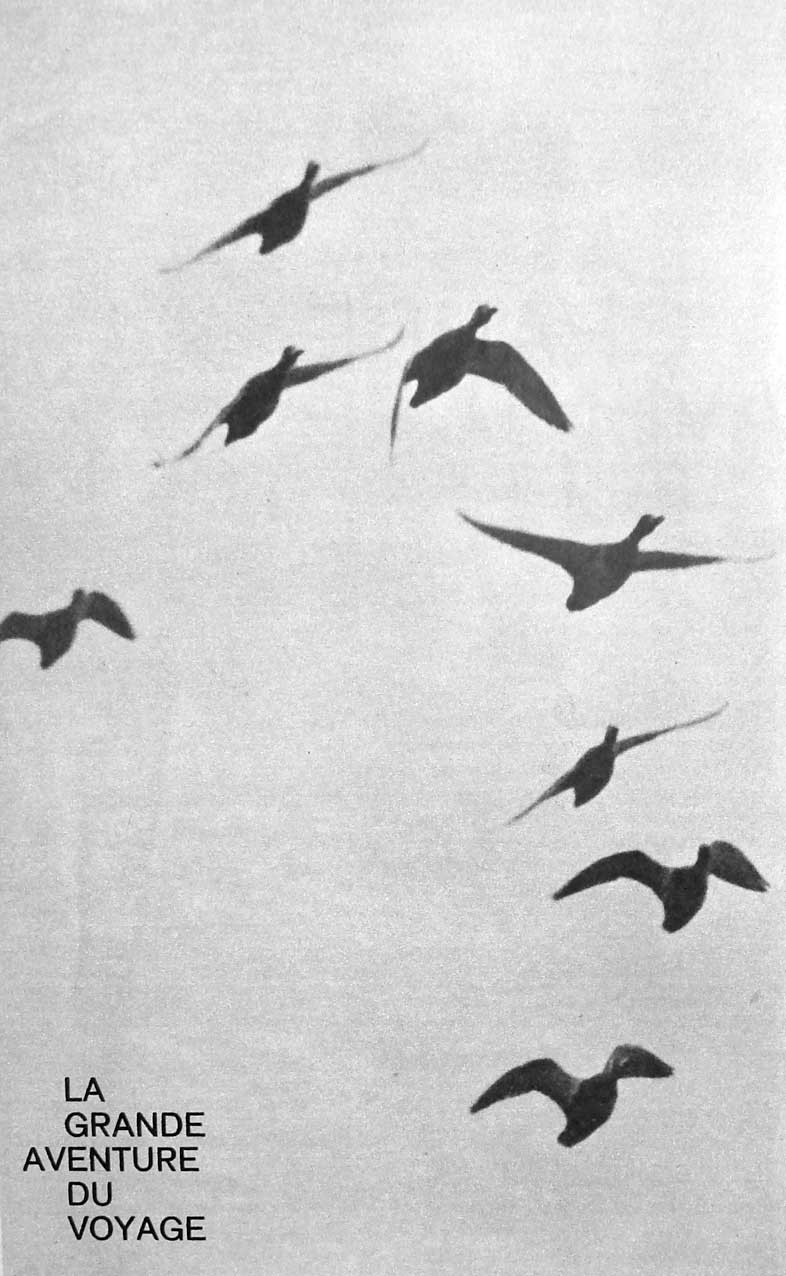
Dans les pages qui suivent, «La Vie des Bêtes», sous la plume d’Aimé Michel, s’attaque à l’un des plus importants des mystères du monde animal: ce goût que manifestent certaines espèces de bêtes pour l’envahissement, la conquête de territoires nouveaux, et la façon dont elles s’y prennent pour mener à bien ces entreprises, qui semblent, parfois, parfaitement concertées. Là aussi, nous avons encore beaucoup à apprendre des naturalistes de terrain…
Le touriste qui, en 1966, arrive pour la première fois devant le lac de Serre-Ponçon par la route de Gap à Embrun, ou encore en descendant la vallée de l’Ubaye, au-delà de Lauzet, ne peut se faire une idée de ce qu’était ce paysage il y a seulement dix ans. Des schistes bleuâtres, ravinés, désolés; deux fonds de vallée sans cesse ravagés par les crues de la Durance et de l’Ubaye; une maigre végétation buissonneuse accrochée aux îles précaires laissées chaque été par ces deux torrents: comment imaginer tout cela sous l’immense plan d’eau, aussi vaste que le lac d’Annecy, où planent maintenant les mouettes?
Et pourtant, le plus étonnant n’est pas la transformation du paysage. Le lac a, pourrait-on dire, fait sa place. Ses couleurs changeantes ont épousé le ciel, les montagnes et les saisons. Même ceux qui ont jadis parcouru à pied les schistes de l’Île-de-Rousset, maintenant noyés sous 120 mètres d’eau, se sont habitués à sa masse. Le plus étonnant, c’est que la vie en ait si vite achevé la conquête.
J’ai parlé de mouettes. Mais les insectes et les oiseaux d’eau douce y sont désormais comme chez eux. Il semblerait que le lac fût là depuis le commencement du monde. On y voit pondre la libellule, courbant et enfonçant son abdomen dans la vase. Le héron y prend ses poses méditatives. Et je ne mentionne même pas les poissons qui eux, ont du moins profité de l’action des sociétés de pêche.
La conquête de ce milieu fabriqué par l’homme, réalisé en si peu de temps, montre le peu d’importance des grands cataclysmes naturels et la fantastique puissance d’adaptation de la vie.
Les animaux sauvages sont d’éternels pionniers. Toute richesse nouvelle offerte à leur expansion est immédiatement conquise. Pourquoi? Parce que l’immense majorité des animaux passent une partie de leur vie à explorer et à voyager. L’activité exploratrice est chez eux constante, même à l’intérieur de leur territoire. Cette activité, conjuguée à la possession du territoire, répond même sans doute à la définition la plus vraie de la vie sauvage. Elle commence dès la naissance chez beaucoup d’espèces, comme le chat, par exemple: le chaton aux yeux encore cousus se déplace en tremblant sur ses petites pattes autour de sa mère, ou, quand elle n’est pas là, autour de la nichée. Cette craintive recherche traduit, au niveau le plus modeste, l’énorme et perpétuel essor de la vie en déplacement.
Certains exemples de conquête sont classiques. On cite toujours (avec raison) le rat noir venu d’Asie au Moyen Âge en bandes innombrables se déversant comme une marée à travers les déserts, les campagnes, les villes, portant avec lui la peste. Au XVIIe siècle, nous dit Jean Dorst, professeur au muséum[1], «ce fut le surmulot, lui aussi originaire d’Asie, qui fit son apparition en vagues énormes, balayant toute l’Europe et éliminant d’ailleurs progressivement le rat noir».
Les grandes invasions
Un exemple plus récent (puisque sa conquête de l’Europe se déroule sous nos yeux) est celle du rat musqué, gros rongeur aux allures de marmotte aquatique que l’on peut voir à deux pas de Paris, par exemple aux étangs de Guipéreux, en Yvelines. Le rat musqué est né américain, et il le serait encore sans l’agrément que les dames trouvent à sa fourrure (c’est le «rat d’Amérique» des fourreurs). Avant la dernière guerre, des élevages de rats musqués furent montés en divers lieux de la moitié nord de notre pays. L’animal s’adapte parfaitement. Il suffisait de lui donner un étang pour le voir se mettre à faire avec les roseaux ce que le castor fait avec les arbres: des huttes, et y proliférer rapidement. Mais le rat musqué ne peut pas être parqué. Il creuse des galeries, s’évade dans la campagne et s’en va coloniser d’autres étangs. Les fleuves et les rivières lui permettent les grands voyages. Actuellement, il occupe pratiquement toute l’Europe, de l’Atlantique à l’Oural. À ma connaissance, il n’a cependant pas franchi les Alpes. «La progression de ce rongeur, écrit M. Dorst, montre comment un animal envahit progressivement de vastes régions jusqu’alors non peuplées par l’espèce. Le pouvoir de reproduction du rat musqué est d’ailleurs stupéfiant. Pas moins de 649’000 peaux ont été commercialisées en 1954 en Union Soviétique et plus de 250’000 en Finlande: ces individus proviennent tous d’un stock très réduit de géniteurs qui se sont multipliés selon une progression géométrique.»
Ce que l’on ne comprend pas dans le cas du rat noir et du surmulot, c’est la raison pour laquelle ces espèces qui existaient en Asie depuis des millions d’années, y restèrent si longtemps cantonnées puis, se mirent un jour à émigrer massivement. Il y a là un phénomène qui semble défier le déterminisme matériel qui, lui, ne changera apparemment pas. On pourrait, en effet, alléguer un changement climatique local. Mais est-il vraisemblable qu’un tel changement ne se soit jamais produit une seule fois depuis des dizaines de millions de siècles, alors que les circonstances météorologiques ne cessent jamais de varier?
L’exemple du lemming, cet autre rongeur qui part en migration massive tous les trois, quatre ou cinq ans, n’explique rien lui non plus. Le lemming obéit à une sorte de cycle mystérieux certes, mais régulier. Dans sa vie normale, il occupe le plateau scandinave et son activité est nocturne. C’est un animal craintif et timide. Au moment de la migration, son caractère change du tout au tout. Il fait preuve, nous dit M. Dorst, «d’une absence totale de crainte, d’une combativité et d’une hargne féroces». Ce type de changement est bien connu en psychologie animale. On l’observe chez les oiseaux au moment du départ en migration. Il résulte de modifications hormonales profondes qui tonifient le système sympathique et accélèrent le métabolisme. Quelles que soient les causes de tous ces changements, ce sont des changements. Au lieu que la ruée vers l’Ouest du rat noir un phénomène qui s’est développé sur des dizaines d’années et même de siècles, et qui ne mettait en jeu aucun fait de comportement proprement dit, autant bien sûr qu’on le sache. L’animal restait semblable à lui-même. Simplement, il partait à conquête du monde. Pourquoi? Disons, jusqu’à ce qu’on ait trouvé mieux, que c’est parce qu’il avait envie de partir. Pour reprendre la constatation humoristique d’un spécialiste américain de la psychologie animale, il faut admettre que, «mis dans des conditions soigneusement déterminées en laboratoire, l’animal, en définitive, fait ce qu’il veut!»
La gélinotte à fraise, qui vit dans l’Amérique boréale, occupe, lors de sa première nidification, un territoire qu’elle gardera jusqu’à sa mort, bien que la température locale puisse varier entre + 35 °C et – 40 °C. Pourquoi ne se sert-elle pas de ses ailes pour éviter ces – 40 °C hivernaux en allant ailleurs? Un vol de quelques centaines de kilomètres lui épargnerait bien de la peine. Elle «préfère» passer l’hiver sous la neige, creusant péniblement des galeries pour chercher les graines dont elle vit. Ceux qui, par confort mental, s’obstinent à croire encore que l’animal est une machine, ont beau jeu de dire que si l’on connaissait toutes les conditions auxquelles la gelinotte à fraise est matériellement soumise, on verrait qu’elle est obligée d’agir comme elle fait.
Dame! avec des si, on répond à tout. Il semble cependant plus conforme à l’observation toute bête d’admettre que ces conditions, on ne les voit pas. Et que le surmulot parti à la conquête du monde ne montre aucune différence avec le surmulot asiatique. Si ce n’est que, de l’Asie, il en a assez, et qu’il a envie de changer d’air.
L’instinct voyageur du caribou
Je regarde dans le livre de M. Dorst (page 44), une admirable photo montrant une harde de cerfs traversant un lac. Serrés les uns contre les autres, le cou tendu, ils progressent dans un tourbillon d’écume blanche, vivante forêt qu’anime le mystérieux instinct de la fuite collective. Y a-t-il un ordre dans cette foule? Autant qu’on le sache, non. Un de nos lecteurs nous demande s’il est exact que les cerfs lancés dans une telle traversée sont appuyés l’un sur l’autre, la croupe de chacun supportant la tête de celui qui le suit. Non! Ce qui est vrai, c’est qu’ils n’avancent qu’en troupe compacte, flanc contre flanc, et que parfois, le poitrail de l’un d’eux touche celui qui le précède. Mais ce n’est pas pour le toucher. C’est par économie d’énergie, pour ne pas gaspiller le tourbillon d’énergie mis en mouvement par lui. Un souci exactement identique groupe les coureurs du Tour de France derrière le leader, l’homme qui «mène» fournit la plus grosse dépense, dont les suivants profitent.

En ce qui concerne les bêtes qui nagent, elles le font aussi près l’une de l’autre qu’elles le peuvent sans se gêner. Outre l’amélioration du rendement énergétique, on a tout lieu de penser que le désir de se sentir soutenues par la présence rassurante du troupeau leur inspire cette disposition. L’eau n’est pas leur élément naturel, ni la nage leur mode de déplacement. La traversée d’un lac ou d’un fleuve est une épreuve que la harde aborde en rassemblant sa force physique et son courage, comme elle fait en présence de tout danger.
Les plus forts et les plus vieux sont-ils en tête? Même pas. On aperçoit souvent et même peut-on dire régulièrement des têtes sans bois parmi les premières bêtes et des bois fortement développés parmi les dernières. En revanche, il est vrai que les juvéniles se trouvent rarement sur les bords. Leurs aînés les encadrent.
Notre correspondant souligne avec raison la ressemblance des photos modernes avec la fameuse frise des cervidés de Lascaux. À Lascaux aussi, où la forme du rocher semble avoir inspiré au peintre paléolithique l’image d’un cours d’eau, on voit de longs cous tendus les uns derrière les autres dans leur effort collectif. On voit au premier coup d’œil que l’auteur de l’admirable fresque a souvent contemplé ce spectacle dans les eaux de la Vézère et de la Dordogne.
Hélas! les vastes troupeaux ont maintenant disparu des forêts du Périgord. Pour avoir une idée de ce qu’ils purent être, il faut aller observer les rennes de Laponie ou, mieux encore, les caribous du Nord canadien (car les rennes, sans être exactement domestiqués, vivent en symbiose avec les Lapons). Les caribous sont de grands voyageurs et obéissent à une double migration. Leur habitat d’été est la toundra, entre la zone des forêts et celle des glaces. Jusqu’au mois d’août, ils s’y déplacent lentement, par petites bandes qui parfois se rassemblent pour former des troupeaux comptant jusqu’à 3’000 têtes. Chaque bande a son territoire, qu’elle revient occuper été après été.
Une première migration vers le sud a lieu au début d’août. Les caribous se tiennent alors pendant un mois et demi environ sur la limite des forêts sans toutefois y pénétrer. Vers la mi-septembre, alors qu’ils sont au meilleur de leur forme, le poil luisant et le flanc prospère, le rut le chasse de nouveau vers le nord: c’est là, où pourtant la nourriture fait déjà défaut, qu’ils vont pendant plus d’un mois de folie sacrifier aux rites de l’accouplement. Pourquoi dans le Grand Nord désert et glacé, alors que la bordure des forêts ferait aussi bien l’affaire? On peut avoir la simplicité de croire que c’est tout simplement parce que cela leur plaît Ils préfèrent le Grand Nord désert et glacé où aucun déterminisme raisonnable ne semble pourtant les pousser. Ce n’est qu’après avoir dûment engrossé leurs femelles qu’ils se décident enfin à descendre définitivement vers le sud. Ils se rassemblent enfin en vastes troupeaux galopant dans les premières tourmentes et, cette fois, ils se réfugient dans les forêts. C’est là, sous l’abri des conifères, qu’ils passeront l’hiver. Le retour vers le nord ne commencera qu’à la fonte des neiges.
Le sens de la route
Les contrées où s’effectuent ces immenses voyages saisonniers sont souvent montagneuses, notamment vers l’ouest. On constate alors que, guidée par un instinct infaillible, les bêtes parcourent toujours le même trajet, et que ce trajet, de col en col, de gué en gué, est le plus économique. «Chacune de ces routes se compose d’une douzaine de pistes de 15 à 30 centimètres de large, que le passage répété d’immenses troupeaux a débarrassés de leur végétation et creusés d’une dizaine de centimètres dans le sol», écrit M. Dorst.
On peut observer cette extraordinaire constance de l’instinct voyageur des bêtes en France même, dans les Alpes et les Pyrénées. Tous les chasseurs de montagne savent que même un animal aussi vagabond que le lièvre passe toujours par les mêmes endroits. Les «postes», pour le lièvre, où le chasseur, tranquillement assis, attend son gibier, n’ont pas changé depuis trois générations dans certain coin de montagne que je connais bien. Combien de générations humaines? Ces postes ne sont apparemment explicables par rien de nécessaire. La bête pourrait passer n’importe où ailleurs. Pourquoi alors passe-t-elle là de préférence? Les observations faites dans la savane africaine par Hediger montrent que cette question doit être posée pour le premier animal seulement. On ne sait pas pourquoi le premier est passé par là. Mais on sait que le deuxième y est passé pour faire comme le premier, par réflexe d’imitation. Aussi incroyable que cela paraisse, les postes du lièvre peuvent se maintenir (si Hediger a vu juste) pendant des dizaines d’années et peut-être des siècles sur les lieux de passage d’un premier lièvre guidé, lui, par Dieu sait quoi!
Toutefois, dans les montagnes, les lieux de passage des bêtes telles que le chamois, le sanglier et la marmotte sont généralement justifiés par la topographie. Ils obéissent d’ailleurs à des lois curieuses. Sur une même crête, le sentier conduisant d’un col à l’autre ne suit jamais la courbe de niveau (sauf pour de très brèves distances): il descend entre les deux comme une corde mal tendue. Pourquoi? Peut-être parce qu’au départ, il a tendance à suivre le sentier qui descend du col vers le fond de la vallée comme la ligne joignant les extrémités d’un X a tendance à suivre les barres de l’X. Cette loi n’est pas suivie par les moutons des transhumants et encore moins par les vaches des alpages, dont les sentiers marquent très souvent les courbes de niveaux. À quoi tient cette différence? À une plus grande paresse de l’animal domestique? À son poids? Un examen attentif des sentiers d’une montagne permet en tout cas très souvent de déceler leur origine. On voit ainsi que certains d’entre eux, qui parfois même sont de véritables chemins, ont d’abord été tracés par les bêtes sauvages avant d’avoir été adoptés par l’homme. Quand ils ondulent de passage à passage au-dessous du niveau de ceux-ci, on peut augurer que l’homme n’en est vraisemblablement pas l’auteur, même si les bêtes qui en sont responsables ont disparu depuis des siècles.
Une hypothèse qui pose des problèmes
Cette stabilité des lieux de passage n’explique pas, nous l’avons vu, leur origine. Pour reprendre l’exemple du lièvre, il est certain que son réseau routier est essentiellement utilisé dans la course et la fuite, hors lesquelles il ne lui répugne pas, loin de là, de glaner à droite et à gauche. La question est donc de savoir pourquoi une piste laissée à l’occasion d’un vagabondage ne semble pas avoir d’autre tendance que celle de s’effacer. Les observations de Hediger montrent là aussi que les bêtes savent parfaitement distinguer les pistes permanentes des autres. Mais à quoi les distinguent-elles? Aux marquages? Le lièvre, par exemple, marque à l’urine. Mais, dans le cas de découvertes intéressantes, que se passe-t-il?
On aurait peut-être une idée des réponses à donner à ces questions en étudiant la conquête d’un nouvel espace-vital artificiel comme le lac de Serre-Ponçon ou comme les divers plans d’eau de la vallée de la Durance. Les habitants de Digne remarquent depuis quelques années la présence de plus en plus fréquente de mouettes sur la Bléone. Est-ce en rapport avec la création de ces plans d’eau? Mais comment les mouettes les ont-elles devinées? Il faut admettre, pour l’expliquer, que l’activité exploratrice et le vagabondage peuvent donner lieu à l’établissement de routes permanentes, encore qu’on ne voie pas quel type de vagabondage peut attirer des mouettes si loin des côtes en l’absence de tout fleuve (lorsqu’il s’agit de lacs). Quelle que soit l’explication proposée, elle ne peut que laisser rêveur. Dans le cas des insectes, le vent doit jouer un grand rôle. La première libellule peut être apportée par une tempête: il ne lui reste qu’à pondre pour qu’aussitôt son espèce se multiplie. Les poissons, eux, sont transportés par les oiseaux sous forme d’œufs fécondés collés au plumage: ainsi, en particulier, s’explique dans la nature le peuplement des lacs de montagne. Pour les oiseaux non migrateurs, le vent est encore possible, à la rigueur, quoique peu vraisemblable. Mais, pour les mammifères, le peuplement d’une aire nouvelle suppose une incroyable souplesse, une divination véritable, ou, peut-être, un grand gaspillage, l’espèce sacrifiant mille ou dix mille individus à des recherches systématiques pour une réussite unique.
Il n’est pas impossible que les luttes des mâles pour la possession des femelles ou des aires de reproduction, si générales dans le monde animal, aient entre autres buts, celui de forcer les mâles dominés à s’expatrier avec leurs femelles, quand il y a couple. Dans ce cas, l’ardeur des mâles aurait pour résultat, outre la reproduction de l’espèce, sa dissémination. Les perdants des combats auraient donc, eux aussi, leur utilisation: comme les cadets de Gascogne, ils iraient chercher fortune ailleurs et porteraient ainsi au loin la présence de leur race.
Ce n’est là, bien entendu, qu’une hypothèse, qui d’ailleurs pose plus de problèmes qu’elle n’en résout. Pourquoi les espèces vivantes sont-elles presque toujours chargées de cet infernal dynamisme? À supposer que les mécanismes qui les lancent et les conduisent dans la grande aventure du voyage soient un jour élucidés, quel est le but de tout cela? Que cherche la nature en répandant le rat noir par milliards, puis en le noyant sous d’autres vagues de surmulots? Quand on voit tant d’être primitifs comme les gastéropodes, par exemple, traverser discrètement les milliards d’années sans disparaître, on se demande à quoi rime cette agitation de la plupart des espèces, non de toutes, pour des résultats équivalents.
On se demande surtout si le dernier venu sur cette planète, l’homme lui-même, n’a pas rassemblé dans son inquiète personne tous les travers étalés avant lui par la vie animale en ébullition. Car qu’est-ce qui ressemble plus à l’aventure du rat noir que celles des Huns, par exemple? Les uns et les autres furent un moment le fléau de Dieu. Puis, la marée se retira, laissant les philosophes à leurs réflexions.■
Aimé Michel
Notes:
(1) Jean Dorst, «Les Animaux voyageurs» (Hachette).
