Féeries des couleurs
Revue La Vie des Bêtes N°116 de mars 1968
Les belles couleurs, dont animaux et plantes se parent au printemps, ne sont pas les jeux du hasard. Elles ont un but très précis, bien exposé ici.
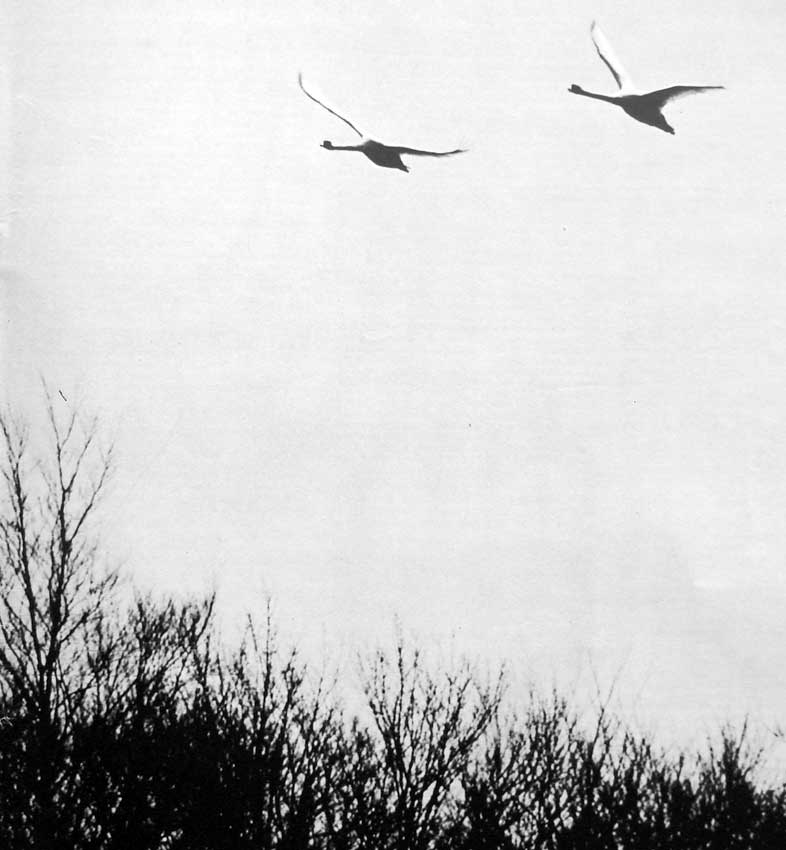
Pourquoi le printemps, l’été et l’automne sont-ils colorés alors que l’hiver est tout en blanc et noir? Cette question semble oiseuse. Je gage que plus d’un lecteur répondra étourdiment — comme je le fis moi-même à un savant ami qui me posait la question — que, la belle affaire! l’hiver est gris parce que la neige et le frimas sont blancs, la terre noire, et que la nature, en hiver, est réduite à son squelette.
— Voire, me dit cet ami d’un air moqueur. Pourquoi le squelette dont vous me parlez est-il gris? Vous avez fait assez de physique pour savoir que si vous prenez des photos d’hiver avec des filtres, le résultat variera avec chaque filtre. Sans même avoir fait de physique, le moindre photographe amateur sait cela. Il sait, selon les circonstances, choisir le filtre qui, en éliminant telle ou telle longueur d’onde — c’est-à-dire, n’est-ce pas? vous êtes bien d’accord? telle ou telle couleur — rendra sa photo plus ou moins nette et plus ou moins contrastée. Le paysage hivernal est donc plein de couleurs, puisque certaines- peuvent même être gênantes. Alors, je vous le demande, pourquoi ne les voyez-vous pas?
— Euh, dis-je, voyons. Peut-être parce que leur mélange les fait se neutraliser entre elles, comme dans le disque de Newton qui, en faisant tournoyer devant l’oeil, avec rapidité, les sept couleurs du spectre, recompose la lumière blanche?
— Et croyez-vous que, dans un paysage d’été, le vrai spectre des couleurs émises soit moins mélangé que dans un paysage d’hiver? Je vais vous mettre sur la voie: vous cherchez une explication physique à ce petit mystère, alors qu’il faut chercher du côté de la biologie et de la psychologie. Il y a, dans un paysage hivernal, et du point de vue de la stricte physique, autant de couleurs que dans n’importe quel autre. La question est uniquement de savoir pourquoi on ne les voit pas.
— Ah, mais oui! Cette fois, J’ai compris! Tout, dans la nature, répond à une adaptation. Si nous voyons l’hiver gris, c’est parce que nous ne gagnerions rien à en voir les couleurs. Notre œil ne nous montre que ce qu’il nous est utile de voir. Cela mérite réflexion. Et je quittai le laboratoire de mon ami, tout pensif.
— Tout est gris en hiver, me disais-je. Tout? Mais non. Presque tout, mais pas tout. Les fruits du houx sont d’un superbe rouge vif. Presque aussi vif le rouge des églantines qu’on appelle chez moi gratte-culs. Les graines de genièvre sont bleues et se voient bien sur la neige. Rouges encore les graines de l’if Taxus baccata. Roses, celles du fusain. Rouge-orangé celles de l’argousier, qui fait, en janvier, de si jolis bouquets – sur les versants sablonneux des Alpes du Sud. Rouges, celles de l’aubépine…
En quelques minutes, j’eus ainsi, tout en conduisant dans la cohue de Paris, passé en revue tous les objets colorés que la nature nous offre en hiver. Et, soudain, quelque chose me frappa: tous ces objets colorés étaient des fruits… Pourquoi les fruits, et eux seuls? La réponse était évidente: parce que tel est l’intérêt de la nature. De même que les fleurs, avec leur somptuosité de formes et de couleurs, sont faites pour attirer l’insecte pollinisateur et fécondeur, de la même façon les fruits présentent des dispositifs destinés à solliciter la consommation. D’abord, il s’agit d’être vu de loin: l’oiseau granivore, presque seul à subsister dans nos climats en hiver, aperçoit le fruit, fonce dessus, le dévore, digère la pulpe… et s’en va déposer au loin la graine précieuse, promesse des futures germinations, bien enrobée dans la crotte fertilisante! Tout cela est admirablement conçu. La nature se repose en hiver. La plante, ni l’arbre n’ont plus besoin de l’oiseau. Ils dorment. Ils ne demandent plus rien à personne. Et parce qu’ils ne demandent plus rien, ils se dépouillent de tout appareil attractif. Sauf, sur un point: le fruit, qui subsiste souvent, accroché aux branches, et qui n’aura pas rempli son rôle tant que nul ne l’aura mangé. Il faut donc attirer le client. Comment? D’abord, en lui offrant quelque chose qui excite sa convoitise: la pulpe, avec son sucre, ses vitamines (les graines d’argousier en sont gorgées, au point que, si elles ne donnaient quelque peu la colique, on en pourrait faire des cures, comme on boit de l’huile de foie de morue!), ses principes nutritifs. Mais il ne suffit pas d’offrir une marchandise de qualité pour avoir du succès. Encore faut-il que le client voie l’article en devanture.
Eh bien, quoi de plus visible dans un paysage d’hiver que le corail d’une graine de houx? Il n’est pas jusqu’aux propriétés laxatives de beaucoup de fruits qui ne puissent être suspectées d’avoir un objectif bien précis: il faut, certes, que la graine soit mangée pour que l’animal se charge de son transport et de sa dispersion. Mais il ne faut pas que la digestion dure trop longtemps, car les acides gastriques sont destructifs. D’où l’adjonction sagement dosée d’un principe laxatif idoine: combien de laxatifs sont tirés de graines, à commencer par l’huile de ricin?
Je n’ai jusqu’ici parlé que des couleurs de l’hiver. Mais l’hiver est une limite: quand arrive la neige, la plupart des fruits ont déjà scellé leur destin. Et les couleurs de l’automne, elles aussi, jouent leur rôle. Aucune étude à ma connaissance n’a encore été faite sur le rôle, s’il en est un, du jaunissement des feuilles dans l’économie du végétal. Le flamboiement du tremble, du mélèze, de tant d’espèces d’arbres, est-il utile à l’arbre, ou bien faut-il le tenir pour un accident, comme le blanchissement de nos cheveux? Il faudrait examiner, par des statistiques, si les arbres les plus voyants en automne ont quelque chose à vendre et, dans l’affirmative, à qui, étudier la vision du client éventuel, etc. Rien de tout cela n’a encore été fait. Ce serait pourtant un beau sujet de thèse.
En revanche, la coloration du fruit mûr répond à un but indiscutable. Tant que la graine est incapable de germer, le fruit qui l’entoure est immangeable et se dissimule de son mieux parmi les feuilles. Ce n’est pas par hasard qu’avant sa maturité, le fruit est vert: il s’agit, à ce stade, de ne pas se faire remarquer. Plus il se confond les feuilles et mieux cela vaut pour lui — c’est-à-dire pour l’espèce dont il porte l’avenir, la descendance — car tout fruit cueilli et mangé immature est perdu, la graine n’étant pas encore en état de germer. Ce n’est pas non plus un hasard si le fruit qui n’est pas mûr est immangeable: il faut, pour l’avenir de l’arbre, qu’il ne soit pas mangé. Il en est, si l’on me permet cette comparaison un peu usée, des fruits comme des jeunes filles, dont les appâts naissent en même temps que la fécondité. La nature ne nous invite à les cueillir que lorsque tout est prêt (je m’abstiendrai, pour ne pas compliquer la question, de parler des dévoyés qui préfèrent les fruits verts…). On remarquera que les fruits immatures revêtent en général la couleur la plus cryptique, de façon à se fondre dans la touffe feuillue. Il n’est vert que sur un arbre à feuilles vertes. Le genièvre immature est argenté comme les feuilles de l’arbuste.
Certains cas particulièrement intéressants mériteraient d’être étudiés de près. Par exemple celui de la viorne dont le fruit, d’abord vert, passe, avant de parvenir à la couleur noire de sa maturité, par un rouge presque aussi éclatant que celui du houx. Indiscutablement, il est bien plus visible rouge que noir. Mais visible à qui? La viorne n’a pas été faite pour l’homme, car elle offrait ses fruits fades (mais non sans charme) des millions d’années avant l’apparition du premier homme. Qui était le client visé? Probablement un daltonien incapable de distinguer le rouge du vert, ce qui peut d’ailleurs avoir été le cas d’un animal maintenant disparu.
Un autre fruit intéressant de nos régions est la groseille à maquereau, que les savants appellent Ribes uva-crispa. Pourquoi cette groseille ne change-t-elle pour ainsi dire pas de couleur en mûrissant? La réponse, là aussi, est, très probablement, qu’elle ne change pas de couleur à nos yeux, mais que le client à qui elle est destinée distingue fort bien, lui, la publicité faite à son intention. Pour comprendre à quel point ce qui est visible à l’un peut ne pas l’être à l’autre, il faut se rappeler que les insectes voient le lis de la même couleur que le coquelicot, c’est-à-dire ni blanc, ni rouge, mais bien ultra-violet. Quant à savoir à quoi correspond pour eux cet ultra-violet, c’est là un problème très intéressant dont je parlerai dans un autre article.
Ce que j’ai dit des fruits et de leurs rapports avec les bêtes nous donne à deviner que la couleur joue un grand rôle dans la vie animale, et que par conséquent au moins un grand nombre d’entre elles sont capables de reconnaître les couleurs. C’est là un fait encore plus évident quand on observe les rapports des animaux entre eux. Si l’on se rappelle que la nature ne fait rien en vain et que l’on ne voit pas les couleurs de l’hiver parce qu’il ne nous servirait à rien de les voir, on doit prévoir que la fantastique diversité de couleurs observée dans le plumage des oiseaux démontre chez eux une vive sensibilité aux couleurs. Voici d’abord des faits qui, en effet, montrent bien cette sensibilité.
L’oiseau est l’insectivore par excellence. Autrement dit, pour l’insecte, surtout volant, c’est l’ennemi naturel et héréditaire. Une large part des défenses de l’insecte sont donc dirigées contre l’oiseau. Ces défenses, quelles sont-elles? Il en existe une infinité, dont parle le Professeur Chauvin dans son dernier livre, une passionnante étude de l’insecte vivant dans son milieu, c’est-à-dire de son écologie, sujet qui n’avait encore, jusqu’ici, fait l’objet d’aucun livre en français[1]. Parmi les moyens de défense que Chauvin suppose connus, j’en citerai deux dont l’action est en rapport avec la vision des couleurs chez les oiseaux:
— D’abord, l’homochromie, c’est-à-dire le fait qu’un nombre fabuleux d’insectes sont exactement de la même couleur que leur milieu vivant, leur substrat. Penser par exemple aux innombrables insectes des prés qui, comme par hasard, sont verts tant que l’herbe est verte, deviennent jaunes quand l’herbe jaunit, qui sont noirs (comme le grillon) quand ils vivent dans l’ombre d’une cavité, etc. Il est assez comique de voir les efforts des néo-darwiniens pour prouver que cette adaptation colorale est un pur hasard, qu’elle ne joue aucun rôle de défense, etc. Elle ne joue aucun rôle, mais les comptages faits sur le terrain montrent que l’insecte homochrome échappe plus souvent à son ennemi que l’insecte visible. Le même résultat s’observe quand on analyse les boulettes (c’est-à-dire les crottes) des oiseaux insectivores, ou le contenu de leur jabot. Que signifient ces résultats? Que l’oiseau voit vert ce qui est vert, jaune ce qui est jaune, etc.
Nous ne voyons pas comme les animaux…
— L’autre fait est l’existence des couleurs avertisseuses chez les insectes immangeables. J’ai déjà eu l’occasion de parler de cette ruse de guerre, l’une des plus curieuses de la vie animale. Elle consiste essentiellement en ceci, que si les insectes tenus par les oiseaux comme ayant un goût délectable sont homochromes, cryptiques, bref, tendent à l’invisibilité, ceux qui au contraire ont un goût répugnant présentent tous des couleurs très voyantes, tranchant vivement sur le substrat. Autrement dit, ceux qui sont mangeables se cachent, et ceux qui ne le sont pas s’exhibent. Pourquoi s’exhibent-ils? Pour ne pas être confondus avec les autres et que les oiseaux, à la vue de leurs vives couleurs, obéissent au réflexe qui est le nôtre devant l’étiquette rouge des poisons. L’un des exemples les plus remarquables est la chenille du Notodonte (Symmerista canicosta) dont on voit une très belle photo dans le livre de A. et E. B. Klots, les Insectes vivants du monde[2]. On trouvera dans le même ouvrage une foule d’exemples des autres ruses employées par les insectes pour tromper ou utiliser à leur profit la vision que les oiseaux ont des couleurs.

Est-ce à dire que les oiseaux voient les couleurs comme nous les voyons? Dans cet article, je n’entrerai pas dans le détail des expériences qui ont été faites sur une foule d’animaux pour mettre en évidence leur vision des couleurs, et me bornerai à citer des faits montrant que cette vision existe. Ce que l’on peut dire toutefois, avant toute étude détaillée, c’est qu’il serait bien surprenant que les oiseaux eussent notre vision des couleurs, puisque cette expression: notre vision ne signifie à peu près rien.
Il y a bien un spectre lumineux du rouge au violet, visible de façon à peu près identique chez une forte majorité des humains. Mais, d’abord, une proportion non négligeable de nos semblables ne voient pas les grandes longueurs d’ondes. Ils sont aveugles dès le crépuscule, car la composante rouge du soleil couchant n’est pas perçue par eux. Ce sont les Protanopes. Puis, il y a les daltoniens, qui ne voient qu’une couleur uniforme là où nous distinguons le rouge et le vert. Fait incroyable, on n’a pas encore réussi à trouver une expérience permettant de savoir si la fondamentale verte manque ou si elle se confond avec le rouge.

Enfin, il y a les tritanopes, qui ne voient pas le bleu. La fameuse «mer violette» des poèmes homériques a permis à certains de soutenir que la distinction entre le bleu et le violet est une acquisition récente de l’espèce humaine.
Il y a mieux encore. On a découvert récemment que la vision des couleurs n’est pas la même selon qu’on a les yeux bleus ou marron! Plus précisément, si les mêmes couleurs sont bien perçues par les yeux bleus et les yeux marron, elles ne correspondent pas à la même impression subjective, de sorte que, s’il était soudain donné à des yeux bleus de voir comme des yeux marron (ou inversement) leur possesseur se croirait transporté sur une autre planète. Des objets, il ne reconnaîtrait que les formes.
On comprend donc que la nature telle que la voit le monde animal (infiniment plus différent de nous qu’un brun aux yeux marron ne peut l’être d’un blond aux yeux bleus) est une pure fantasmagorie. Rien ne peut nous en donner une idée. Nous pouvons essayer de la comprendre, non de l’imaginer. Encore ne sommes-nous pas sûrs de tout pouvoir comprendre, et je n’en veux pour preuve que l’énigme toujours intacte de l’orientation des oiseaux migrateurs: il s’agit bien d’un sens, quelque chose comme la vue ou l’ouïe. Comment le nid lointain est-il perçu, subjectivement, par l’oiseau? comme une forme? comme un endroit plus brillant sur l’horizon? Un jour, peut-être, nous comprendrons quand même le mécanisme. Mais, quant à imaginer ce que l’oiseau éprouve, il n’en est pas question.
Revenons à la vision des couleurs. Nous avons vu qu’elle joue un rôle essentiel dans le comportement des bêtes à l’égard de leur milieu naturel (couleur des fruits, des fleurs, etc.), à l’égard de la proie (homochromie, aposématisme — c’est-à-dire couleurs avertisseuses). Mais c’est dans leurs rapports réciproques que l’on voit surtout la couleur commander et orienter le comportement des animaux. Du moins chez les oiseaux, les insectes et les poissons.
Les mammifères sont des êtres à prédominance olfactive. Ils se guident surtout aux odeurs, y compris ceux qui disposent d’une vision à peu près semblable à celle de l’homme, comme les singes et les écureuils. J’ai eu l’occasion de dire la raison de cette prédominance du nez chez les mammifères: c’est que cette grande famille, à l’exception de la chauve-souris, vit dans un univers plat, à deux dimensions, où le marquage du territoire se fait plus efficacement en déposant des odeurs en guise de poteaux-frontières. L’odeur reste là, même quand celui qui l’a déposée s’en va. C’est très pratique.
Chez l’oiseau, au contraire, et chez tous les êtres volants, il faut trouver autre chose, car on ne peut déposer une odeur fixe dans le milieu aérien, sans cesse en mouvement. Alors, l’oiseau utilise les autres organes des sens pour avertir qu’il est là et qu’il est chez lui: il chante et il exhibe des couleurs reconnaissables de loin.
Les couleurs jouent surtout un rôle éminent dans les rapports entre sexes. Il y a d’extraordinaires exemples, comme celui de la frégate, oiseau de haute mer. Le mâle de la frégate ne se signale par aucune plume ornementale. «Il cache ses charmes, écrit Madeleine Pierre-Grassé, auteur de deux captivants ouvrages sur la vie amoureuse des bêtes[3], et ne les dévoile qu’au plus fort de sa cour. Face à la femelle, il déploie ses ailes et gonfle comme une outre un sac aérien qui longe le cou et descend très bas sur le poitrail. La peau de cette région est dénudée et, pendant la saison des amours, se colore en rouge-sang. La femelle, stupéfiée, s’accroupit devant son seigneur et détourne la tête, comme éblouie.» Le «sac aérien» de la frégate est énorme. Il faut, comme on dit, le voir pour le croire: rien ne ressemble plus à un ballon rouge prêt à éclater.
Parade amoureuse et couleurs somptueuses
C’est là assurément un cas limite, mais qui témoigne que la frégate femelle est particulièrement sensible à la couleur rouge. Chez tous les autres oiseaux sans exception (la frégate n’est d’ailleurs pas seule à exhiber des ballons rouges), la parade amoureuse comporte un étalage des parties colorées du plumage. Beaucoup d’entre eux ouvrent leurs ailes pour en montrer la face inférieure, généralement plus claire: on observe particulièrement bien ce manège chez le coq de nos basses-cours, qui tourne autour de sa belle en étendant jusqu’au sol l’aile du côté- opposé. Chez le paon, l’étalage atteint la somptuosité que l’on sait.
Les poissons, pourtant si éloignés de l’oiseau dans les parentés animales, présentent des mœurs tout à fait comparables, et cela, pour la raison qu’eux aussi se meuvent dans un espace à trois dimensions. Innombrables sont ceux qui, au moment des amours, se revêtent d’une parure spéciale, vivement colorée, où généralement, le rouge prédomine. On sait que les plus brillantes couleurs s’observent chez les poissons tropicaux Eh bien, on a remarqué que les parades amoureuses des poissons à vives couleurs se déroulent près de la surface, là où la lumière du soleil fait chatoyer le plus avantageusement les merveilleux ornements des futurs époux.
La couleur, indiscutablement, séduit d’un bout à l’autre du monde animal, à l’exception — relative — des mammifères, famille prosaïque qui ne sait ni chanter ni se parer. Je dis que l’exception est quand même relative, car en cherchant bien, on trouverait quelques mammifères brillamment ornés: «Certains singes, comme le mandrill mâle, arborent une face bleue et rouge, que l’on croirait sortie des mains du maquilleur», dit Madeleine Pierre-Grassé.
Et puis, n’est-ce pas, il y a l’homme. Ou plutôt la femme. On pourrait ici s’interroger: pourquoi le sexe orné est-il le sexe masculin chez les animaux et le sexe féminin dans l’espèce humaine? La réponse me parait évidente: chez les animaux, on veut plaire à l’autre partenaire, alors que la sophistication de la pensée fait apparaître la complaisance pour soi chez l’homme et chez la bête. C’est bien le sexe faible qui aime les couleurs. Ces dames cherchent la beauté en face. Mais, en face, dans notre espèce, c’est d’abord le miroir. Et, ma foi, qui s’en plaindrait?■
Aimé Michel
Notes:
(1) Rémy Chauvin: Le Monde des Insectes (Hachette, 1967).
(2) A. et E. B. Klots: Les Insectes vivants du Monde (Hachette) p. 172.
(3) Madeleine Pierre-Grassé, La vie amoureuse des vertébrés (Hachette); Madeleine Pierre-Grassé est la femme du grand biologiste Pierre Grassé.
